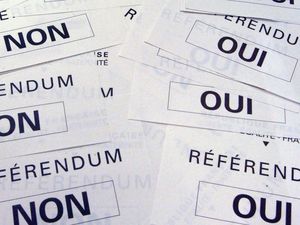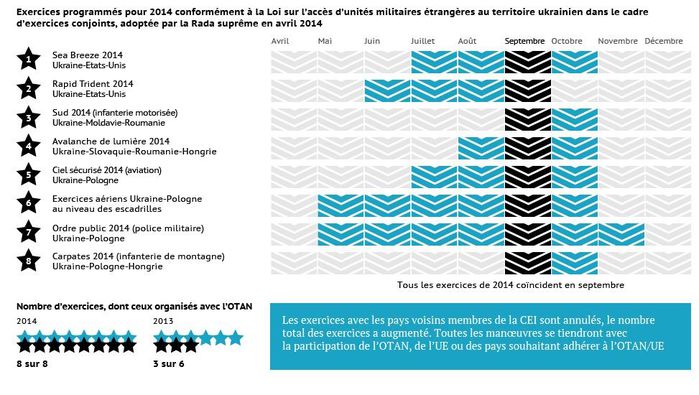Vu l’ampleur du texte (plus de 1 500 pages avec les annexes), la présente analyse procède pour l’instant d’une première lecture, et n’offre pas, bien entendu, d’avis exhaustif sur l’ensemble du texte. Son passage au crible nécessitera plusieurs semaines voire plusieurs mois à nos organisations tant il est complexe, conçu par des spécialistes pour des spécialistes. Bien trop tard, en somme, pour mener le travail d’information et de mise en débat auprès du public, pourtant indispensable au regard de l’étendue des bouleversements politiques qu’induira cet accord : le texte devrait être clos le 25 septembre prochain sans que les citoyens n’aient eu l’opportunité d’en être saisis, donc sans que les élus français ou européens n’aient eu l’opportunité d’infléchir son contenu.
L’analyse d’un certain nombre de ses aspects majeurs permet toutefois de saisir la portée considérable du texte proposé aux États membres, qui devrait être officiellement validé (donc considéré comme clos) le 25 septembre prochain lors d’un sommet entre l’UE et le Canada.
Le Secrétariat d’État français au Commerce extérieur doit urgemment faire traduire et divulguer ce texte, et le soumettre à toute ou partie (les Commissions compétentes par exemple) du Parlement français, ainsi qu’à tous les acteurs de la société civile intéressés au résultat de la négociation : paysans, syndicats, associations de protection de l’environnement, associations de consommateurs, chercheurs et experts indépendants…
À cette fin, les Parlementaires français pourraient interpeller le Premier Ministre Manuel Valls et le Ministre de tutelle du Secrétariat d’État au Commerce extérieur, M. Laurent Fabius, pour qu’ils ouvrent instamment un débat parlementaire concernant le contenu du texte.
La France, dans le cadre du Conseil des ministres du Commerce extérieur et dans le cadre du Trade Policy Committee, doit instamment appeler à la publication du texte de l’accord CETA, et l’organisation d’une consultation publique large et contraignante par la DG Commerce.
- La France doit demander la révision complète et substantielle du chapitre 10 sur la protection des investissements.
- La France doit demander la révision complète et substantielle du chapitre 26 relatif à la Coopération réglementaire, et de toutes les dispositions sectorielles organisant la coopération entre des autorités de régulation hors des circuits de contrôle démocratique et citoyen.
- La France doit étendre la liste des exceptions qu’elle instaurera aux obligations génériques de non-discrimination et du traitement national telles que listées dans l’Annexe 2, en particulier concernant tous les services d’intérêt général.
- La France doit refuser toute disposition dont la formulation allusive pourrait remettre en question son droit d’invocation du principe de précaution.
- La France doit demander l’introduction du droit à réguler en disposition première et surplombante, de même que contraignante à l’ensemble du texte. Une telle affirmation ne remettra pas en cause la protection légitime des investisseurs en cas de déni évident de justice, mais elle permettra d’éviter la multiplication de recours et de litiges abusifs visant à faire supprimer des règles et normes protégeant à la fois les peuples et la planète, et à dissuader la puissance publique d’exercer son droit souverain à protéger l’intérêt général.
L’accord se divise en 42 chapitres : les 2 premiers sont consacrés au préambule et aux définitions, les 7 derniers clarifient une multitude de situations juridiques particulières à travers des déclarations spécifiques (comme le cas d’Andorre, une déclaration sur les Vins et spiritueux, etc.).
La plupart des chapitres portent sur l’organisation de la libéralisation du commerce entre les deux Parties en s’appuyant sur des principes comme le « Traitement national », la « Clause de la nation la plus favorisée » (clause dite « MFN ») ou traitent de questions telles que les subventions, la facilitation du commerce et les procédures douanières, les « règles d’origine », les « barrières au commerce », « mesures sanitaires et phytosanitaires », etc. Certains chapitres portent plus spécifiquement sur les services et l’investissement. Enfin, l’aspect « dérégulation » est traité de manière disséminée dans plusieurs chapitres tels que le chapitre 26 sur la « Coopération réglementaire », les 27, 28, 29 portant sur les divers protocoles de reconnaissance mutuelle de normes dans divers domaines (produits pharmaceutiques, matières premières, etc.), le 31 sur la transparence, le 33 sur le mécanisme de règlement des différends investisseurs-États.
L’accord se complète de quelques 1 000 pages d’annexes diverses dédiées au calendrier, aux offres respectives des parties négociantes, au détail des exceptions qu’elles réservent aux différents volets de l’accord…
Cet accord n’est pas seulement un accord de libre-échange, il s’agit avant tout d’un accord de dérégulation. Il doit être compris pour ce qu’il est, un précurseur politique de l’accord UE/États-Unis.
Comme accord de libre-échange, il opère la plus large libéralisation du commerce international entre l’Union européenne et le Canada, en allant plus loin que les accords de l’OMC.
En tant qu’accord de dérégulation, il installe deux mécanismes qui institutionnaliseront les droits exceptionnels des entreprises transnationales (ETN), désormais appelées à co-écrire les règles les concernant et à déterminer le périmètre de l’intervention publique sans aucune validation démocratique : le mécanisme de règlement des différends Investisseur-État et le « Forum de coopération réglementaire ». Les ETN jouiront grâce à cet accord d’un privilège, celui de se voir appliquer des procédures particulières en dehors du droit commun.
De façon assez habituelle dans ce type de texte, le préambule de l’accord rappelle les principes qui ont officiellement conduit sa rédaction, à savoir la recherche de la croissance et du développement dans le respect des « Droits humains ». Il est fait référence à la Convention de l’UNESCO sur la diversité culturelle et affirme le droit des États de réguler dans ce domaine, y compris par un soutien financier aux activités y afférant. Le préambule affirme également que l’accord « préserve le droit (des Parties) de réguler sur leur territoire (et de) préserver la flexibilité nécessaire pour mettre en œuvre les objectifs de politiques publiques légitimes comme la santé publique, la sûreté, l’environnement, la morale publique et la promotion et la protection de la diversité culturelle ».
Une fois ces affirmations générales faites, l’accord organise pourtant concrètement les moyens de réduire le droit des États à réguler et de donner aux ETN un rôle surplombant. En effet le préambule n’a pas de vocation contraignante pour l’ensemble du texte, alors que les mouvements citoyens demandent de longue date l’affirmation du droit à réguler en article premier de l’accord, et la soumission de toutes les dispositions suivantes à ce premier article.
Au delà du préambule, comme prévu, l’accord réduit les droits de douane agricole dans un certain nombre de produits, et modifie les quotas fixés à l’encontre des viandes canadiennes (entre autres). Mais nous aurons besoin de plus de temps pour analyser les dispositions agricoles en détail.
Il consacre une attention particulière aux indications géographiques, tel que l’UE le défend depuis le lancement de ses négociations avec le Canada et les États-Unis.
Il comporte une partie significative sur les procédures de facilitation du commerce, dans la continuité de la tendance lourde actuelle : dématérialisation des documents de douanes, échange d’informations automatiques (art. X 3-3 et 4. et X-8), mise en place d’un organisme conjoint chargé de simplifier les procédures en douanes (le JCCC art X-14).
Les chapitres 10 et 33 traitent de la protection des investissements, dont la mise en place, à cet effet, d’un mécanisme de règlement des différends investisseur-État.
Le chapitre « Investissement » décrit les conditions d’accès au marché pour les investisseurs de chacune des Parties (article X-4) et stipule comme prévu qu’elles devront accorder en général un traitement rigoureusement identique, en situation identique, aux entreprises nationales et à celles de l’autre Partie (traitement national). Ce principe consiste à considérablement libéraliser les investissements canadiens dans l’UE, et réciproquement, d’autant plus que le texte établit la liste précise de toutes les types de mesures qui seront prohibées par l’accord. Certaines de celles-ci sont d’ailleurs hautement problématiques : par exemple les alinéas 2-a, 2-d ou 2-e de l’article X-4, qui prohibent l’introduction de restrictions liées à la volonté de réguler l’usage des terres, de protéger l’environnement ou de limiter la consommation de ressources naturelles, ou encore de limiter le nombre de licences ou d’autorisations dans le domaine des télécommunications en raison de contraintes physiques ou techniques.
Les alinéas 1-b et 1-c de l’article X-5 relatif aux « exigences de performance » que pourrait fixer l’une ou l’autre des parties à un investisseur sont également problématiques : elles interdisent en effet à une collectivité publique de fixer des seuils minimaux de contenu local à un investisseur, de même que de donner préférence à des produits ou des services locaux dans leurs commandes publiques.
De même le texte prohibe le conditionnement d’avantages (en nature ou sous forme de subventions) à des critères de contenu ou d’origine locale.
Le texte précise ensuite, toutefois, qu’aucune de ces dispositions ne pourra empêcher une collectivité de conditionner un avantage, en particulier une subvention, à l’exigence de « localiser la production, fournir un service, former ou employer des travailleurs, construire ou développer des facilités ou des infrastructures, ou conduire des activités de recherche-développement sur le territoire ». Mais c’est là le propre des subventions.
La section définissant les obligations de protection des investissements des parties au traité détaille la définition de l’expropriation directe ou indirecte (Annexe X-11 de la section investissements), sachant que cela peut être défini par un faisceau d’indices multiples parmi lesquels le fait que les mesures ont un « effet sur la valeur économique de l’investissement » (Annexe 11, 2-a) ou qu’elles aient un impact sur les « retours sur investissements raisonnablement escomptés » (2-b). Le texte permet donc aux entreprises européennes et canadiennes de fonder la rentabilité de leurs investissements sur une garantie de stabilité réglementaire et/ou normative, garantie du financement immédiat de leur projet et garantie des profits futurs.
Ce point est extrêmement important et il est nouveau. Le caractère extraordinairement flou de la notion ouvre toutes les portes aux interprétations favorables aux entreprises, et suspendra une épée de Damoclès sur toute décision publique ; comment la puissance publique pourrait-elle effectivement garantir l’intangibilité des lois et des règlements applicables aux acteurs économiques privés ? C’est pourtant bien ce que suggère le texte de l’accord. De plus, seront attaquables les mesures « manifestement excessives », y compris celles prises dans le but de protéger des « objectifs publics légitimes tels que la santé, la sûreté et l’environnement », mais seulement dans des « circonstances exceptionnelles » (point 3 du même article).
Le texte précise également la notion de « traitement juste et équitable », fréquemment invoquée dans les litiges relatifs à l’investissement, et considérée par les observateurs indépendants comme bien trop floue et subjective dans les traités existants, en particulier ceux initiés par les États-Unis. L’article X-9 circonscrit un peu mieux la notion, pour la limiter aux cas évidents de déni de justice, de discriminations évidentes liées au sexe, à la race ou à la religion de l’investisseur, et à la violation des dispositions relatives à la non-discrimination, au traitement national et à la clause « MFN ». Il précise également qu’une violation d’une autre clause du traité ne constituera pas un motif de violation des obligations de traitement « juste et équitable » à l’égard d’un investisseur (et ne pourra donc automatiquement fonder un litige arbitral).
La section 5 de la partie dédiée à la protection des investissements est consacrée quant à elle aux exceptions possibles au reste des dispositions générales définies préalablement en la matière. Elle stipule que les réserves possibles aux obligations en matière d’investissement sont libellées dans les annexes 1 et 2 du traité.
Or la liste des réserves formulée au plan communautaire, comme par la France spécifiquement, ne semble pas spécifier clairement que les services d’intérêt général que sont l’éducation, la santé ou encore les services sociaux seront explicitement des secteurs soustraits à la libéralisation des investissements. Tout au plus est-il fait mention de la possibilité, pour l’UE ou pour l’un de ses États membres, d’interdire ou de limiter la prise de participation étrangère dans des entreprises publiques ou dans une structure considérée comme gouvernementale. Mais qu’en est-il de la prise de participation étrangère dans des entreprises de statut privé qui fournissent pourtant des services publics ou d’intérêt général sur une base contractuelle avec l’État ou toute autre collectivité publique ?
En outre les organisations de la société civile avaient beaucoup insisté pour limiter l’usage des listes négatives dans la définition du droit des autorités publiques à réguler et à définir leurs priorités de développement ; elles ont à l’inverse défendu l’affirmation de celui-ci comme le droit commun, assorti de la liste précise des offres d’accès au marché et de facilités faites aux investisseurs. Mais l’analyse de ces annexes démontre que la crainte du système de liste « négative » était parfaitement fondée puisque le droit à réguler est réduit à l’état d’exception, dont la démonstration du bien-fondé reviendra à la puissance publique. Qu’adviendra-t-il de la volonté publique de réguler dans tous les secteurs non listés en annexe du traité lorsque l’intérêt général l’exigera ? Sera-t-elle susceptible d’être attaquée par une entreprise puis soumise à une procédure d’arbitrage ? Et comment sera régulé l’investissement dans des secteurs qui viendraient à émerger dans le futur ? La logique du texte voudrait qu’il ne puisse faire l’objet d’aucune limitation à l’avenir puisqu’aucune mention n’en est faite dans les annexes présentes.
La section 6 du chapitre 10 décrit précisément le fonctionnement du mécanisme d’arbitrage proposé en cas de litige entre un investisseur et l’une des parties au traité.
Pour rappel, cette clause d’arbitrage permettra aux multinationales canadiennes, ainsi qu’aux autres, notamment américaines possédant une filiale au Canada, de contester les lois et décisions publiques européennes qui affecteraient leurs profits. De telles clauses dans d’autres accords ont déjà permis à des multinationales de contester une augmentation du salaire minimum en Égypte, la sortie de nucléaire ou la protection des rivières en Allemagne, des avertissements de santé sur les paquets de cigarettes en Australie, ou encore ont permis de condamner l’état argentin pour avoir contrôlé le prix de l’eau dans un contexte de grave crise sociale. Les condamnations se traduisent par des amendes en millions voire en milliards d’euros.
Ce mécanisme reprend ce qui est connu désormais dans le chapitre 11 de l’ALENA et dans les quelques 3000 accords bilatéraux sur l’investissement existants.
Il est à noter que le texte exclut l’« importation de clauses » (article X-7, alinea 4) dans le cadre de procédures d’arbitrage, ce qui signifie que l’application de la clause de la Nation la plus favorisée ne pourra permettre à une entreprise (ou aux arbitres d’un différend) de l’invoquer pour exiger des avantages conférés à une partie tiers dans le cadre d’un accord préférentiel plus avantageux [2]. C’était une crainte des organisations de la société civile, que les parties ont prise en compte.
Lorsque le différend porte sur l’investissement, la procédure suivie sera, au choix des parties, celle établie par le CIRDI, par UNICITRAL ou tout autre que les parties choisiront. Sinon, la procédure suivie sera conforme aux règles de l’OMC. Dans tous les cas, il s’agit qu’un organe composé de trois arbitres internationaux, désignés par les parties, qui examine les plaintes des investisseurs (c’est à dire des entreprises) contre des réglementations publiques. L’article X-27 de la section sur l’investissement précise que les arbitres ainsi nommés appliqueront les règles de l’accord. Seule la Convention de Vienne sur l’interprétation du droit des Traités est évoquée, convention qui porte uniquement sur la manière générale de comprendre les traités. Cela veut dire qu’aucun autre texte, de quelque nature que ce soit, ne sera pris en considération par les arbitres, sauf indication contraire de l’accord de commerce invoqué dans le litige. Seule limitation possible : le Comité sur les services et l’investissement pourra proposer au Comité commercial, tous deux instaurés par le traité, une « interprétation contraignante » du texte qui s’imposera aux arbitres. Cette restriction est pour le moins limitée.
La procédure elle-même débute par des consultations et des médiations entamées par une entreprise qui souhaite voir écarter une réglementation (section 2 du chapitre 33), puis, en cas de différend persistant, par la désignation des trois arbitres chargées de trancher le litige. Ces personnes ne doivent pas bénéficier d’un intérêt particulier dans le cas à juger et se conformer à un Code de conduite censé éviter les conflits d’intérêts. Or ces garanties quant à l’éthique et la qualification des arbitres ne suffisent pas, comme l’expliquent de nombreux travaux, par exemple ceux des juristes de l’Institut international pour le développement durable [3] : ils resteront choisis par les parties au litige, et seront nécessairement intéressés à son résultat, dans la mesure les avocats-conseils des parties sont également susceptibles de siéger en tant qu’arbitres. Aucune sanction n’est en outre précisée en cas de manquement.
Ce panel d’arbitrage est habilité à sanctionner les États à la demande des entreprises ressortissantes de l’autre Partie.
Les conséquences de ce type de dispositions sont connues : le flou des motifs pour lesquels les États peuvent être attaqués, l’opacité des procédures d’arbitrage, la connivence des arbitres avec les milieux d’affaires (pour dire le moins), ont amené à des condamnations qui, en retour, ont pour effet d’inhiber le champ de l’action publique et l’affaiblissement des réglementations protectrices des populations. Au mépris des principes démocratiques essentiels, est installé un véritable privilège en faveur des seules entreprises transnationales.
Il faut tout d’abord noter que le texte fuité n’introduit pas d’harmonisation ou de reconnaissance mutuelle des normes qui fonctionnerait de manière automatique et globale.
En matière de reconnaissance mutuelle par exemple, le chapitre sur les normes sanitaires et phytosanitaires (SPS – chapitre 7) stipule bien qu’une Partie n’acceptera la norme SPS de la partie conjointe que si cette dernière démontre « objectivement » que sa norme fournit à la Partie « importatrice » le niveau approprié de protection.
Le texte prévoit cependant à travers la coopération réglementaire (Chapitre 26) des mécanismes qui pourront faciliter la convergence des règlementations et mesures existantes et futures, y compris celles de protection des consommateurs, des travailleurs ou de l’environnement. Les dispositions regroupées sous ce nom de coopération réglementaire permettront une co-écriture des réglementations par les multinationales des deux côtés de l’Atlantique, bien après la ratification de l’accord par les instances démocratiques compétentes, et sans aucun contrôle ultérieur.
La logique exposée dans cette section est la suivante :
- les parties au traité ont déjà des engagements multilatéraux en matière de coopération réglementaire, notamment dans le cadre de l’OMC, et reconnaissent le bien-fondé de la coopération réglementaire,
- elles affirment leur détermination à assurer un haut niveau de protection du bien-être des humains, des animaux et des végétaux.
- sur la base de ces engagements, elles s’engagent à mettre en œuvre la meilleure coopération possible dans le domaine de l’élaboration, l’évaluation et la révision des diverses normes (sanitaires, phytosanitaires, administratives, industrielles, de conformité des procédures…)
Pour une part d’entre eux, les objectifs assignés à ce chapitre sont légitimes : partager un maximum d’informations, échanger sur les risques et situations diverses rencontrées par l’une ou l’autre des parties et qui intéressent l’autre, se tenir informés des initiatives de régulations qu’elles prendront respectivement lorsqu’elles concerneront un aspect ou l’autre du présent traité, en anticiper par des études et recherches les conséquences commerciales…
Mais l’article X-2-4 introduit des objectifs nettement plus problématiques : « : « Sans limiter la capacité de chaque Partie de conduire ses propres politiques législatives et réglementaires de régulation, les Parties s’engagent à développer leur coopération réglementaire à la lumière de leur intérêts communs dans le but de : (a) prévenir et éliminer les barrières non nécessaires au commerce et à l’investissement, ; (b) renforcer le climat de compétitivité et d’innovation, incluant la recherche de la compatibilité réglementaire, la reconnaissance mutuelle et la convergence ; et c) promouvoir des processus transparents, efficaces et effectifs qui améliorent les objectifs de politiques publiques et remplissent les mandats des institutions de régulation, ce qui inclut la promotion de l’échange d’informations et celle des bonnes pratiques. »
Bien entendu l’article X-5 précise : « Ces considérations n’empêcheront pas l’une ou l’autre des Parties d’adopter des mesures différentes répondant à des approches différentes liées à des processus institutionnels et législatifs différents , ou à des circonstances, des valeurs ou des priorités spécifiques à cette Partie. »
Un des risques majeurs réside toutefois dans l’absence de clarté et de précision quant aux modalités de composition, de saisine, de décision et de contrôle du « Forum de coopération réglementaire » mis en place (Article X-6) et responsable d’organiser ce dialogue institutionnel entre les deux Parties. Pourtant celui-ci aura toute compétence pour consulter en toute opacité les « parties privées » (les lobbies de toutes sortes – art X-8) tout au long du processus. Il sera supervisé par un haut-fonctionnaire issu de chacune des Parties, qui auront toute latitude pour inviter « les parties intéressées » aux questions traitées à leur convenance ; il ne sera donc soumis à aucune obligation d’impartialité et de consultation égalitaire entre tous les acteurs concernés.
Il adoptera son propre cahier des charges et sa propre feuille de route, et sera responsable devant le « Conseil du CETA » (l’organisme de supervision de la mise en œuvre du présent accord), en somme des fonctionnaires de la DG Commerce de l’UE et du Ministère canadien du Commerce.
En outre les champs de compétences thématiques ou sectoriels de ce Forum de coopération réglementaire ne sont en rien limités. Or le texte ne donne aucune sorte de précision sur la façon dont sera organisée la participation des États membres et de leurs organismes régulateurs compétents, pas plus que sur la façon dont les circuits de supervision institutionnelle et politique que devra respecter ce FCR.
On voit que ce mécanisme pose deux types de problèmes :
- L’accord est « vivant » : l’élaboration et l’évolution réglementaires se poursuivront après la conclusion et la ratification de CETA, sur tous les sujets que les deux parties jugeront nécessaires, si bien qu’aucune disposition d’harmonisation ou de démantèlement des régulations ou réglementations existantes n’est nécessaire dans le présent texte. Toute nouvelle réglementation devra être soumise au préalable au Forum de coopération réglementaire, qui pourra décider de son devenir ; les instances élues compétentes sur les matières concernées dans les pays du l’UE et au Canada n’interviendront au mieux qu’en bout de course, sans avoir pu se prononcer a priori, quand elles sont pourtant les seules légitimes à déterminer, et assurer, l’intérêt général
- Il s’agit de mettre en place, à travers le Forum de coopération réglementaire, un comité composé « d’experts », non contrôlés par la puissance publique et par les citoyens, chargés de régulièrement revenir sur les réglementations existantes qui seraient jugées trop lourdes pour la compétitivité des entreprises.
Ces deux aspects nous paraissent poser un problème démocratique fondamental.
On trouve un autre exemple de cette possible coopération réglementaire dans la section 29 du texte, à travers l’article X-03, qui traite de la coopération bilatérale en matière de biotechnologies. Rappelons que sont classifiées « biotechnologies » les organismes génétiquement modifiés ou encore les nanotechnologies.
À première vue le texte appelle tout simplement à développer cette coopération dans le cadre d’une instance déjà existante, créée en 2009, le « Bilateral Dialogue on Biotech Market Access Issues ». Mais les objectifs assignés à ce « Dialogue » laissent penser qu’il pourrait jouer un rôle actif dans la libéralisation du commerce des produits OGM entre l’UE et le Canada. Il se voit ainsi confier la responsabilité de « promouvoir des processus d’approbation basés sur une science efficace concernant les biotechnologies », façon subtile de remettre en cause les méthodologies scientifiques en vigueur dans l’UE comme au Canada, et de discréditer, en particulier, le principe de précaution européen. Il devra également « engager une coopération réglementaire pour minimiser les effets commerciaux adverses des régulations limitant l’usage et le commerce des biotechnologies ». Or qui compose actuellement ce « Dialogue », quelle est la qualification de ses membres, quelles garanties présente-t-il d’une indépendance minimale vis à vis des grands acteurs économiques du secteur, comment sera-t-il contrôlé, ses décisions seront-elles soumises aux représentants élus des citoyens, et dans quelles conditions ?
Les agriculteurs canadiens pratiquent également la chloration de la viande de bœuf, et il est probable que les producteurs obtiendront sa reconnaissance dans l’UE, si pas directement dans le texte de CETA, via le « comité conjoint sur les mesures sanitaires et phytosanitaires » institué par l’accord.
Le Canada a proposé d’inclure dans CETA des références aux droits du travail, dont ceux promus par l’OIT, en y assortissant des mécanismes de plaintes et de sanctions financière ou amendes en cas de violations [4].
Mais selon les dernières informations disponibles [5], en dépit de ces demandes, la Commission et les États Membres ont refusé d’inclure cette approche dans le texte final.
Dans le texte fuité, un chapitre entier (24) est consacré au droit du travail. Il affirme l’application des 4 Conventions internationales de l’OIT (liberté d’association et de négociation collective, élimination du travail forcé ou contraint, abolition du travail des enfants, élimination des discriminations au travail, art 3-1 du chapitre 24) et la nécessité de « promouvoir » l’agenda sur le travail décent.
Toutefois, certaines formulations sont inquiétantes : l’article X-3-3 qui annonce que les Parties qui ont l’intention de prendre des mesures de protection sociale doivent « tenir compte des connaissances scientifiques et techniques pertinentes et des standards, lignes de conduites recommandations internationaux s’ils existent, particulièrement s’ils affectent le commerce et l’investissement des Parties ». Il serait ainsi possible pour les entreprises de contester des mesures relevant du droit social dès lors qu’elles pourraient ne pas suivre des recommandations internationales par définition très en dessous de ce qui se pratique effectivement dans notre droit. Qui définit en outre les « connaissances scientifiques et techniques pertinentes » ?
Ce chapitre ne traite ni des conditions d’autorisation d’entrée et de travail, ni d’obtention de la nationalité mais des « personnels essentiels, prestataires de services contractuels, professionnels indépendants, visiteurs d’affaires court-terme » (art X-1-2 du chapitre) détachés sur le territoire de l’autre Partie. Cela semble vouloir indiquer que seuls les personnels ayant une compétence particulière sont concernés et uniquement par des contrats de travail courts.
Toutefois, la pratique déterminera ce que les entreprises feront des dispositions de cette partie de l’accord. Les directeurs, les gestionnaires de haut-niveau sont concernés et il n’y a pas de doute sur le fait que leurs contrats seront avantageux. Toutefois, quelle sera l’utilisation que feront les entreprises des salariés même très qualifiés dans le cadre des ’Fournisseurs de contrat de service et travailleurs indépendants’, utilisable dans le cadre d’une prestation de moins de douze mois (art 8-1-a du chapitre) ? Certains salariés sont très qualifiés mais néanmoins soumis à une certaine concurrence (les ingénieurs dans certains domaines, par exemple). Pourraient-ils entrer dans ce cadre ? Quels seraient leur contrat, notamment en termes de cotisations sociales sur place ? N’y a-t-il pas là un effet indirect sur le niveau de protection sociale et de financement des régimes obligatoires de protection sociale ?
Si une Inspection du travail est prévue, aura-t-elle les moyens d’exercer sa mission ? Cela ne semble pas certain.
Concernant les services (Chapitre 11), qui constituent 70% des emplois et de l’économie européenne, CETA consacre l’ouverture à la concurrence internationale, sauf pour certains secteurs explicitement préservés.
Tous les services sont concernés a priori. Les seules exceptions définies en introduction du chapitre concernent :
- Les services fournis dans l’exercice d’une autorité gouvernementale (ici sont surtout concernés les questions de défense et de sécurité et les systèmes publics de protection sociale),
- Pour l’UE, les services audiovisuels,
- Pour le Canada, les industries culturelles,
- Les services financiers traités ultérieurement,
- Les services aériens et les services qui leurs sont liés (sécurité aéroportuaire, contrôles aériens, la maintenance et la réparation aérienne, services logistiques au sol et aux escales etc),
- La vente et la promotion de services de transports,
- Les systèmes de services liés à la sécurité informatique,
- Les marchés publics destinés à un usage gouvernemental et sans objectif de re-commercialisation,
- Les subventions et soutiens gouvernementaux liés au commerce des services.
Le texte confirme l’effet de « cliquet » exposé dans la clause de « non-retour » (ou « standstill » en anglais), art. 8-1 du chapitre 3 et qui couvre le chapitre sur le commerce des services. Ce qui aura été libéralisé le restera, ce qui signifie l’impossibilité, dans le futur, de définir de nouveaux services publics ou de remettre sous contrôle public des services jadis délégués à des opérateurs privés. Remunicipalisation ou « republicisation » de services locaux par exemple seront passablement compliqués par l’accord proposé.
Le Canada a simplement négocié une clause de sauvegarde pour l’agriculture (art 8-3).
Les services publics sont-ils concernés ? En principe oui, car les restrictions, qui sont définies dans les annexes I et II (respectivement sur les mesures existantes et futures), n’excluent pas clairement les services d’intérêt général. Faut-il en déduire que seuls les services régaliens de l’État pourraient échapper à la logique marchande qui impliquera la mise en concurrence des opérateurs domestiques avec des investisseurs privés ?
Concernant les services financiers (traités principalement dans le chapitre 15), l’essentiel des clauses décrites dans le chapitre 10 sur l’investissement sont applicables. Les restrictions à l’investissement dans ce domaine ne sont pas davantage autorisés que pour les autres services (cf chapitre 10 sur l’investissement, chapitre 11 sur le commerce des services) mais l’article sur les « exigences de performance » laisse une période de 3 ans supplémentaires pour que les Parties se mettent d’accord.
Le Canada semble avoir négocié une « niche » prudentielle (article 15), justifiée par l’existence de règles plus contraignantes à l’égard des acteurs financiers canadiens, qui avaient d’ailleurs permis à Ottawa de surmonter la crise de 2008 sans grands dommages [6].
Mais cette niche semble assez fragile : dans l’hypothèse d’une plainte portée par un investisseur (voir article 20) contre une clause prudentielle décidée par l’une ou l’autre des Parties, elle sera tout d’abord soumise à un Comité d’experts paritaire, qui devra décider au consensus si la disposition attaquée constituait bien une protection légitime du point de vue de la puissance publique, ou bien une entrave aux droits de l’investisseur. Et faute de consensus, la mesure sera portée devant un tribunal d’arbitrage, avec les modalités d’organisation définies dans le chapitre 10 qui s’appliquent intégralement ici.
L’accord étend par ailleurs les possibilités pour les entreprises européennes des banques et de l’assurance de prendre des participations dans des établissements homologues canadiens, sans réciproque européenne.
L’accord reconnaît certes aux Parties de droit de poursuivre des politiques publiques de protection de l’environnement et de mettre en place les instruments multilatéraux négociés dans ce domaine. Les articles X-4 et X-5 du chapitre 25 affirment notamment que les Parties ne doivent pas user d’une réglementation plus faible pour attirer les investissements, en somme pratiquer le dumping environnemental.
Ce chapitre « Commerce et développement durable » est dans l’ensemble assez précis et détaillé quant aux modalités de consultation de toutes les parties concernées (précisant l’obligation d’une participation égale des organisations de la société civile et des entreprises aux débats, par exemple, ou encore détaillant les modalités de travail avec les États membres).
L’article X-6 reconnaît aussi aux États le droit d’imposer certaines obligations aux entreprises installées sur son territoire, si toutefois celles-ci ne sont pas « inutilement compliquées et prohibitives ». Ce type de dispositions ouvre néanmoins la porte à toutes les interprétations possibles : une interdiction de la fracturation hydraulique n’est-elle pas « inutilement compliquée et prohibitive » pour un industriel disposant de permis d’exploitation d’hydrocarbures de schiste ?
L’article X-8 risque aussi de poser un sérieux problème d’interprétation puisqu’il prévoit que les restrictions au commerce et à l’investissement posées par des réglementations environnementales ne seraient acceptées que si elles « tiennent compte des informations scientifiques et techniques pertinentes. » Le principe de précaution est certes admis mais dans une certaine mesure seulement, par l’alinéa 2 de l’article X-8, qui affirme qu’aucune des Parties, face à des menaces sérieuses pour l’environnement, ne pourra invoquer le manque de certitude scientifique comme motif pour différer des mesures politiques indispensables lorsqu’elles seront « rentables » ! Mais qu’adviendra-t-il lorsque ces mesures décidées par une collectivité publique ne le seront pas, tout simplement parce qu’elles ne peuvent l’être (un moratoire, la protection d’une zone fragile ?…) ?
Ce chapitre pose en réalité un problème majeur, et de principe : si les engagements des Parties à l’égard des Accords multilatéraux sur l’environnement sont réaffirmés, de même que la nécessité d’optimiser l’appui mutuel que peuvent s’apporter l’armature réglementaire commerciale et son équivalent en matière environnementale, la supériorité de cette dernière sur le droit du commerce et de l’investissement n’est pas affirmée. Aucune hiérarchie de droit n’étant introduite, la préoccupation des Parties à préserver les normes et accords environnementaux multilatéraux ou domestiques ne trouve aucun caractère contraignant, et ne sera d’aucun appui clair en cas de différend.
Les marchés passés dans le cadre de la défense, et/ou portant sur le matériel de guerre, ou qui impliquent des enjeux de sécurité importants, ou qui mettent en jeu un intérêt vital d’une Partie sont exclus (art III-1). L’article III-2-d semble par ailleurs exclure que des marchés publics soient pourvus grâce au travail des prisonniers et dans des conditions allant à l’encontre de la morale et de l’ordre publics.
En dehors de cela, les principes posés sont ceux de la non-discrimination entre opérateurs répondant aux marchés publics (égal accès, traitement national), ce qui enterre en principe toute possibilité de faire prévaloir les circuits courts, d’exiger un statut local de l’entreprise répondant aux marchés (déjà interdit en UE, même si subsistent encore des possibilités de biaiser), ou encore d’introduire des critères de durabilité écologique (plafonds d’émissions de CO2 par exemple, plafonds de consommation de ressources non-renouvelables…). Bien entendu les engagements des parties au titre de la non-discrimination et du traitement national ne les obligeront pas à violer les normes protégeant l’environnement et leurs engagements internationaux ou domestiques en la matière, mais engager la transition écologique et sociale aurait exigé de doter les collectivités publiques d’armes claires en cette matière, faute de quoi elles seront susceptibles d’être attaquées par un entrepreneur estimant ses droits lésés.
De ce point de vue, l’article IV-5 va donner lieu à débat d’interprétation : sans refuser que le cahier des charges du marché public indique les règles d’origine des produits à fournir, il faut que la règle d’origine inscrite ne soit pas « différente de celles des règles d’origine que la Partie applique au même moment pour exporter ordinairement les mêmes marchandises ou fournir les mêmes produits ou service de la même Partie. » Cette formule alambiquée indique-t-elle que des règles de provenance ou de contenu local ne pourront constituer des conditionnalités de cahiers des charges que si des normes équivalentes non seulement existent dans l’autre Partie mais en plus sont invoquées dans des appels d’offre de rang similaire ? Si oui, alors les collectivités publiques auront très peu de marge de manœuvre pour privilégier des opérateurs locaux ou d’inclure des critères de durabilité environnementale, dans leurs choix.
Très clairement, ce chapitre permettra aux opérateurs des deux côtés de l’Atlantique de répondre efficacement aux appels d’offres de l’autre Partie ; cela augmentera sans doute le coût de la réalisation des appels d’offre mais ne changera pas ce dernier point pour les collectivités publiques dans l’UE. Sur le plan économique, les grands opérateurs verront de nouvelles opportunités de marché mais les opérateurs locaux risquent de ne jamais avoir la taille critique pour certains marchés.
CETA exporte le modèle européen de réglementation sur la propriété intellectuelle. Alors que de nombreuses voix appellent à réviser ces réglementations pour les mettre en conformité avec le Protocole de l’ONU sur les droits économiques, sociaux et culturels, l’UE fait tout l’inverse en exportant son modèle et en le rendant immuable, dans un traité international extrêmement difficile à réviser. Les paragraphes de l’article 5 renvoient néanmoins à la loi interne le soin d’organiser les contrôles et les sanctions.
Le droit des marques sort quant à lui renforcé par une mise en commun systématique des marques et indications géographiques protégées par les deux Parties. La liste des indications géographiques européennes protégées dans le cadre de l’accord est longue et détaillée (les principaux bénéficiaires en sont l’Espagne, la France et l’Italie, la Grèce dans une moindre mesure), quand celle du Canada est entièrement vierge. C’est une nouvelle qui conviendra probablement aux producteurs agricoles ou agroalimentaires européens, mais qui interroge sur la symétrie de la négociation en ce domaine : les terroirs canadiens n’ont-ils rien à défendre dans ce domaine ?
Concernant les médicaments, la protection va de 2, 5 ou 10 ans selon les cas. Par ailleurs, la production et l’exportation de médicaments génériques est possible aux conditions de la déclaration de l’OMC du 30 août 2003.
Par bien des aspects, CETA constitue un test, un cheval de Troie du traité transatlantique (TTIP/TAFTA). Pour des raisons historiques et grâce entre autres à l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), les économies canadienne et étasunienne sont fortement imbriquées. Tout disposition jugée dangereuse dans TAFTA (l’accord commercial EU – États-Unis) doit donc dès maintenant être retiré de CETA. Une fois le processus de ratification de CETA engagé, le texte sera « à prendre ou à laisser ». Si les points préjudiciables y demeurent, les parlements nationaux et le Parlement européen ne pourront qu’en rejeter l’ensemble.
Si ces menaces graves ne peuvent être retirées du texte, il faudra les mettre en balance avec le gain économique estimé pour l’UE : 11,7 milliards € annuels après 7 ans de mise en œuvre de l’accord [7], soit une croissance économique supplémentaire de 0,09% annuel. Ce gain dérisoire, qui correspond à la projection la plus optimiste de la Commission européenne, justifie-t-il des transformations politiques, légales et réglementaires d’une telle ampleur pour les citoyens canadiens et européens ? Nous pensons que non.